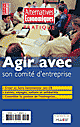
Restructuration et plan social : quand les Comités d’entreprises s’en mêlent
Le rôle du comité d’entreprise ne se limite pas à l’organisation de loisirs et de spectacles. Il peut être un moyen, certes limité mais néanmoins utile, de contrôler la gestion de l’entreprise.
Le Progrès de Lyon, quotidien régional de Rhône-Alpes, perd de l’argent et voit sa diffusion baisser depuis plusieurs années. Pour faire des économies, la direction du journal a lancé en 2004 le projet Millenium qui a pour objectif affiché d’alléger la masse salariale et modifie considérablement l’organisation du travail. Face à cela, le comité d’entreprise du journal a utilisé son droit d’alerte (voir ci-dessous) et analysé en détail la nouvelle organisation du travail issue de la mise en réseau de l’ensemble des agences locales et du site centralisé qui met le journal en pages…
On compte environ 30 000 comités d’entreprise aujourd’hui en France, en majorité dans les entreprises de plus de 50 salariés, où leur création est obligatoire, mais aussi parfois dans des PME. Organisateurs d’activités sociales et culturelles pour les salariés, les CE sont aussi obligatoirement informés et consultés sur la gestion de l’entreprise. Présidés par le chef d’entreprise, ils se composent à la fois d’une délégation du personnel élue et de représentants syndicaux désignés. Par leur biais, les salariés ont donc un droit de regard sur de nombreux domaines, allant du temps de travail jusqu’aux réductions d’effectifs, en passant par l’introduction de nouvelles technologies, comme on le voit avec le Progrès de Lyon. Mais la capacité des CE à intervenir demeure très limitée en France, en comparaison notamment avec la législation en vigueur en Allemagne : alors que le Betriebsrat allemand doit donner son accord pour toute embauche ou licenciement, le CE français a juste le droit de donner son avis et d’émettre des vœux.
Ainsi, le CE du Progrès de Lyon a commandé un rapport au cabinet d’expertise Alpha. Celui-ci met en lumière le renforcement des contraintes pour les correspondants locaux et pour les secrétaires de rédaction et, à l’inverse, l’allégement de la charge de travail des techniciens qui s’occupent du montage des pages au point de faire peser des risques pour l’emploi. Conscient « qu’une grande partie du travail des monteurs disparaît », le CE, s’appuyant sur ce rapport, préconise un autre scénario que la suppression des emplois et propose de former les techniciens de maquette pour faire évoluer leur métier et assurer la pérennité de leur fonction. Sera-t-il suivi par la direction de l’entreprise ? Rien ne l’y oblige…
Les effets de la crise
Pourtant, les attributions économiques des comités d’entreprises n’ont cessé d’augmenter au fil des années. Lors de leur création par l’ordonnance de 1945, il était prévu que les CE soient informés sur les questions touchant à la vie économique de l’entreprise et qu’ils puissent se faire aider d’un expert-comptable pour analyser les comptes annuels de la société. La loi du 16 mai 1946 est tout de suite allée plus loin, en précisant que les comités doivent être non seulement informés, mais aussi obligatoirement consultés sur les questions concernant l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise, et en particulier sur des décisions pouvant affecter l’emploi. De même, l’expert-comptable qui les conseille peut désormais être librement choisi par eux.
Même si les avis et ces vœux du CE ne s’imposent pas à l’employeur, celui-ci doit rendre compte de manière motivée de la suite qu’il leur donne. Par ailleurs, le CE dispose d’un droit d’initiative et de proposition. Et la direction de l’entreprise doit également rendre compte, en la motivant, de la suite donnée aux propositions du comité. Si le chef d’entreprise ne suit pas la procédure, le CE peut saisir la justice. L’employeur peut en effet être condamné au pénal pour délit d’entrave.
A partir de la fin des années 60, la protection des élus en cas de licenciement est mieux assurée et la section syndicale d’entreprise est reconnue en 1968, deux avancées sociales très importantes qui facilitent l’action des CE. Et chaque nouveau texte de loi sur le droit du travail ou l’entreprise, à partir de cette période, associe les CE d’une façon ou d’une autre : l’ordonnance de 1967 sur la participation et l’intéressement leur confie la négociation de ces modes de rémunération complémentaire des salariés, la loi de 1971 sur la formation professionnelle prévoit leur consultation, et celle de 1975 sur les licenciements économiques prévoit qu’ils donnent leurs avis.
Les lois Auroux du 28 octobre 1982 marquent dans cette évolution un tournant important. Elles élargissent les prérogatives des CE en créant notamment un budget de fonctionnement dont le montant s’élève à 0,2 % de la masse salariale brute. Ce budget permet aux CE de former leurs élus et de financer une expertise comptable indépendante. De même, elles créent des comités de groupe, afin d’informer les membres du CE à une échelle plus pertinente. Enfin, le CE peut aussi, dans le cadre de ses prérogatives économiques, avoir recours au droit d’alerte, afin d’agir en amont quand les élus, au vu des informations dont ils disposent, sentent peser un risque sur l’emploi. Ce droit permet de demander à l’employeur des explications sur des faits « préoccupants » qui pourraient avoir des conséquences sur la situation économique de l’entreprise.
Pour autant, comme l’explique le juriste Jacques Le Goff, « la réforme tombe en pleine crise, à un moment où les CE sont le dos au mur et se trouvent dans bien des cas voués à limiter les dégâts des plans de restructuration plus qu’à contrôler, au jour le jour, la gestion de l’entreprise ».
Un contexte incertain
Sur le terrain, François Cochet, expert auprès du groupe Secafi-Alpha constate également que, même si le droit d’alerte est de plus en plus utilisé, les CE ne parviennent pas encore à anticiper d’éventuelles crises. De même, leur action évolue, sous l’effet des contraintes de la réalité économique, vers un certain « réalisme ». « Jusque dans les années 80, rappelle François Cochet, les CE étaient plutôt réticents à négocier les plans sociaux par exemple car ils en combattaient le principe même. » A partir du milieu des années 80, les comités d’entreprise ont commencé à discuter du contenu des plans sociaux. Et « depuis quelques années, les CE se battent plutôt sur les moyens concrets mis à disposition par l’entreprise dans le cadre du plan social pour que les salariés puissent se reclasser ».
Hélène Robert du cabinet Syndex constate de son côté que « nous sommes dans un contexte économique de plus en plus incertain. Il y a 15 ans, le périmètre des entreprises et des groupes ne changeait pas tous les ans, comme c’est actuellement le cas. Avec les restructurations, les directions qui sont en face des CE ne sont plus toujours décisionnaires. Et même lorsqu’elles sont de bonne foi, elles appartiennent à un groupe tellement important qu’ils ne peuvent pas voir tous les enjeux, avoir toutes les informations et il est de plus en plus difficile de collecter et de traiter les informations pertinentes. »
Face à ce contexte, en réaction à des plans de restructuration qui secouent l’opinion (Michelin, Danone…), la loi de modernisation sociale de 2002 avait pour ambition de renforcer encore le pouvoir des CE, et notamment les droits des comités d’entreprise en cas de projet de restructuration et de compression des effectifs. « Il ne s’agissait pas d’un droit de veto, mais tout de même d’un large droit d’opposition suspensif », commente le juriste Maurice Cohen.
Or, « dès son arrivée au pouvoir en 2002, la nouvelle majorité de droite s’est attachée à défaire une partie des réformes antérieures », rappelle Maurice Cohen, et les articles de la loi de modernisation sociale ont été carrément supprimés par la loi du 18 janvier 2005 dite de « programmation pour la cohésion sociale ». Celle-ci a supprimé le droit d’opposition du comité d’entreprise avec saisine d’un médiateur ; l’obligation de consulter le comité sur la stratégie avant la consultation sur les licenciements ; l’obligation d’une négociation préalable sur la réduction du temps de travail ; la réunion du comité en cas d’annonce publique ; la consultation spécifique avant le lancement d’une offre publique d’achat (OPA), etc.
Pour autant, selon Christian Dufour, directeur-adjoint de l’Institut de recherches économique et sociales (Ires), les comités d’entreprise vont souvent au-delà de leur rôle simple rôle d’information et de consultation, « éventuellement jusqu’à la négociation », en principe réservée aux délégués syndicaux. En effet, beaucoup de CE sont tenus par des élus syndiqués. Aussi, fait remarquer le chercheur, « quand des délégués syndicaux y siègent, quand la direction de l’entreprise leur donne réellement les informations nécessaires, les comités d’entreprise sont de véritables instances de représentation des salariés ».
|
Surveiller et proposer Pour prévenir des licenciements, le comité d’entreprise doit se faire force de proposition. Et afin d’être prêt, le CE doit jouer en amont son rôle de veille économique et examiner les comptes chaque année. Ce suivi a permis aux élus du comité d’ECCE, entreprise d’habillement, de voir venir les problèmes économiques : « Quand on a su que notre client Yves-Saint-Laurent, qui représentait 30 % de notre chiffre d’affaires, dénonçait le contrat de licence, on a su que c’était grave, se souvient Monique Merceron. La direction, de son côté, espérait faire valoir que le contrat ne pouvait être rompu. On a déclenché la procédure de droit d’alerte en novembre 2000. » Christelle Fleury |
|
Pour Aller plus loin Le droit des comités d’entreprise et des comités de groupe, par Maurice Cohen, éd. LGDJ, 2005. Comités d’entreprise. Enquête sur les élus, les activités et les moyens, Michel Cézard, Renaud Damesin, Christian Dufour, Daniel Furjot, Adelheid Hege, Catherine Nunes, Catherine Vincent, co-éd. Ministère de l’emploi et de la solidarité-L’Atelier, 1998. Du silence a la parole, une histoire du droit du travail, des années 1830 à nos jours, par Jacques Le Goff, éd. Presses universitaires de Rennes, 2004. L’introuvable démocratie salariale, par Jean-Pierre Le Crom, éd. syllepse, 2003. Agir avec son comité d’entreprise, Alternatives économiques pratique n° 24, mai 2006, voir : www.alternatives-economiques.fr |

